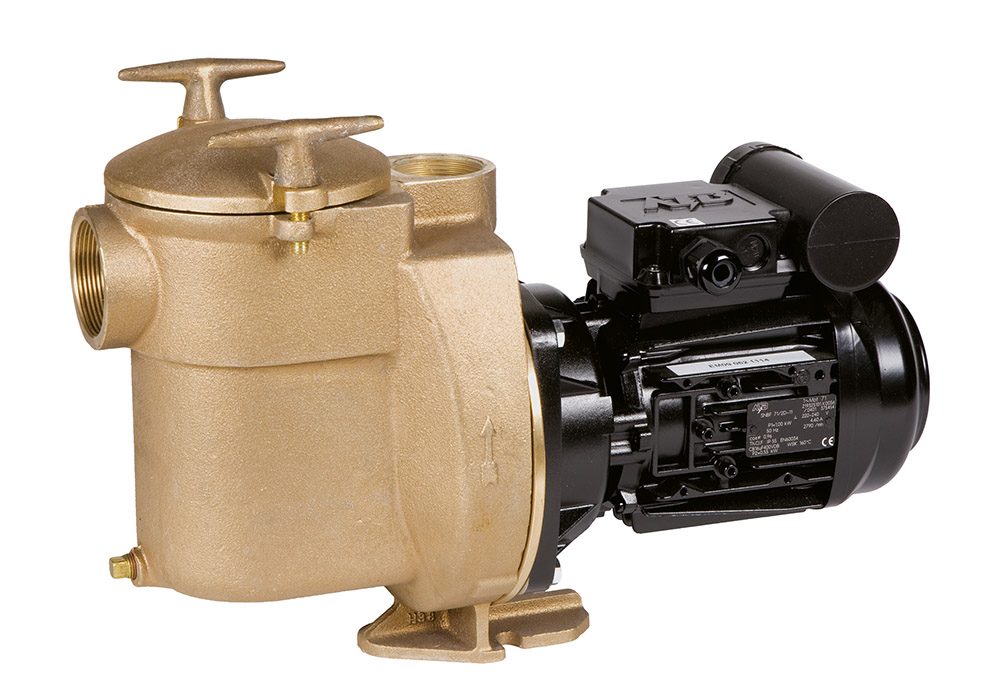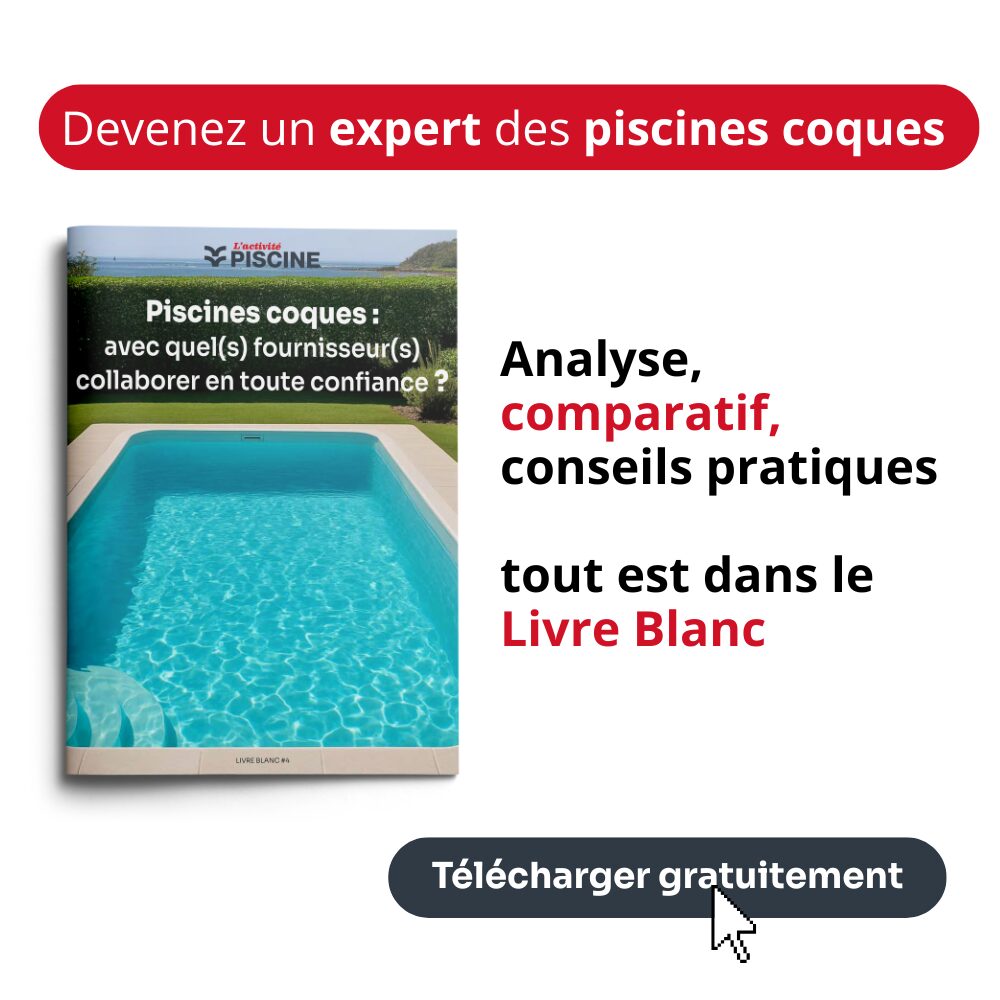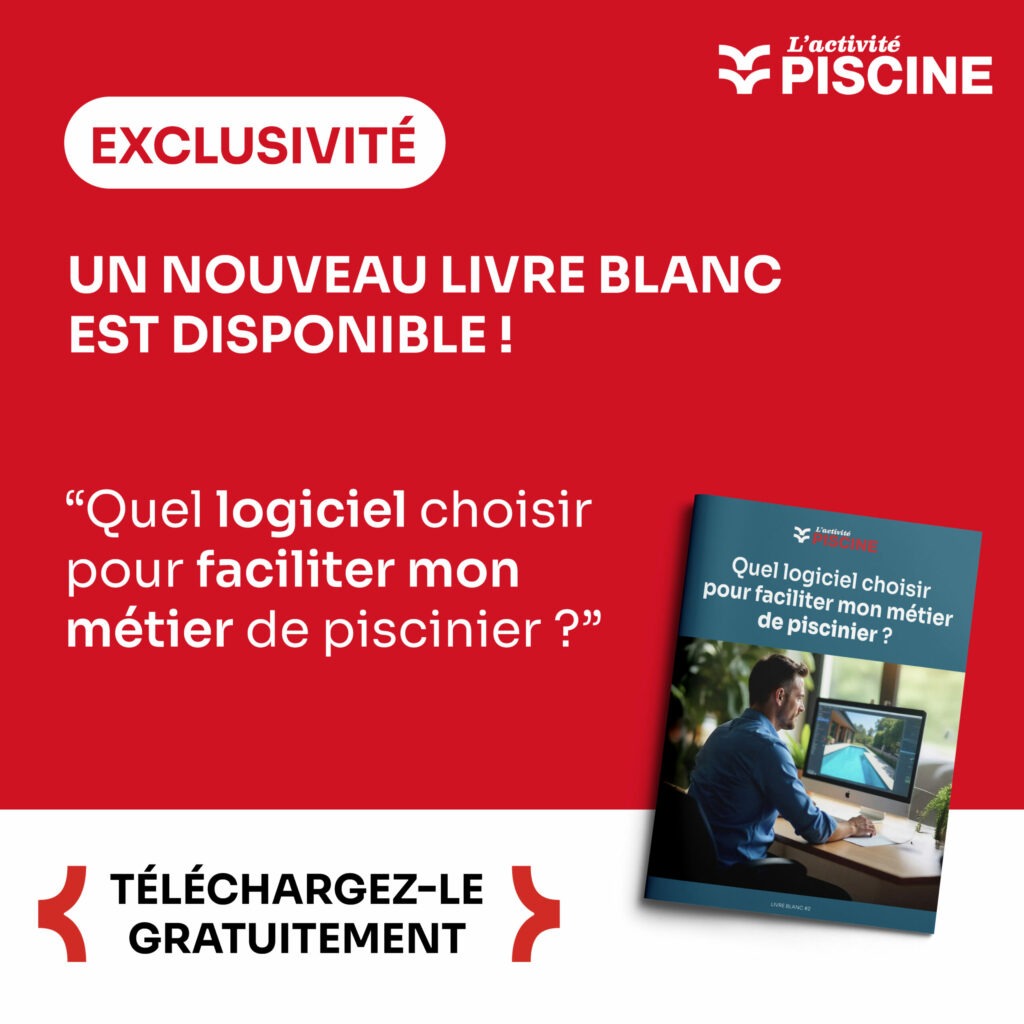Chaque année, l’actualité estivale est marquée par des cas de noyade. On peut regretter que l’instantanéité médiatique soit privilégiée au détriment d’une analyse de fond. Les médias entretiennent ainsi un climat anxiogène, propice aux amalgames qui stigmatisent la piscine auprès du plus grand nombre.
Professionnels, il vous est ainsi peut-être arrivé d’être confronté à des clients inquiets vous questionnant sur les risques potentiels que représente leur piscine, existante ou en projet. Il est donc utile d’avoir en votre possession un argumentaire tangible s’appuyant sur des données chiffrées objectives pour convaincre d’éventuels clients réticents. Il vous permettra également de mettre en exergue l’efficacité d’un système de sécurité et ainsi générer un chiffre d’affaires supplémentaire.
Analyse statistique : ce que disent les chiffres
Ce n’est pas dans les piscines qu’il y a le plus d’accidents
Les données fournies par l’Institut de veille sanitaire (InVS) permettent d’appréhender l’importance du nombre de noyades survenues dans une piscine privée et de les comparer à l’ensemble des accidents. Entre 2003 et 2012, on constate que la proportion d’incidents concernant la piscine privée est relativement stable : entre 12,21 % et 14,90 %, la tendance étant plutôt à la baisse. Il en est de même pour les décès entraînés par une noyade : entre 10,26 % et 13,72 % d’entre eux ont eu lieu dans une piscine privée. Concrètement, cela signifie que près de 9 noyades sur 10 n’ont pas lieu dans une piscine privée.
##img4688##Source : enquêtes Noyades réalisées du 1er juin au 30 septembre 2003, 2004, 2006, 2009, 2012, sur toute la France par l’InVS.
*La noyade se définit comme une « suffocation due à une immersion dans l’eau ». Au sens strict, la noyade est suivie d’un décès. Mais, dans ces enquêtes, le terme de noyade est employé au sens large, qu’elle soit suivie ou non d’un décès. Les noyades répertoriées sont celles qui ont nécessité une hospitalisation.
Les piscines privées (à usage individuel ou collectif) se révèlent donc bien moins accidentogènes qu’un plan d’eau naturel et que la mer où, avec l’océan, se passe plus de la moitié des noyades accidentelles chaque année. Alors que près d’un cinquième de la population déclare ne pas savoir nager, il est bon de rappeler qu’une piscine constitue l’endroit idéal pour se familiariser avec l’eau et débuter son apprentissage de la nage, en toute sécurité.
Le nombre de noyades accidentelles est à mettre en relief avec l’évolution du parc de piscines privées en France qui, sur cette même période, a augmenté de plus de 80 %, passant de 928 000 bassins à 1 675 680. L’analyse des chiffres révèle depuis 2003 – année de la canicule et de la mise en place de la réglementation de la sécurité des piscines privées – une baisse de la proportion des bassins concernés par une noyade. En 2003, on dénombrait en moyenne 18,53 accidents pour 100 000 piscines. Cette fréquence a depuis diminué régulièrement pour atteindre 9,49 cas de noyades pour 100 000 bassins en 2012. Ces chiffres prouvent l’efficacité des systèmes de sécurité définis par la loi du 3 janvier 2003 rendus obligatoires pour la totalité des bassins à compter du 1er janvier 2006. Sans oublier les campagnes de communication à l’initiative de la FPP ou des différents acteurs du marché.
Les points forts de votre argumentaire
• La piscine n’est pas un lieu de baignade dangereux : 9 noyades sur 10 se sont produites ailleurs que dans une piscine privée.
• Pas de vagues ni de courant, un espace sécurisé, une eau limpide… La piscine est l’endroit idéal pour apprendre à nager.
• Depuis la loi de 2003, le nombre de noyades par rapport au parc existant est en constante diminution : l’efficacité des dispositifs normalisés rend les piscines privées de plus en plus sûres.
• Alors que les enfants de moins de 6 ans sont les plus concernés par un accident, les statistiques montrent que les dispositifs de sécurité prévus par la loi contribuent à garder leur vie sauve.
• Un équipement de sécurité perd toute son efficacité s’il ne fonctionne pas correctement. Il est important de le contrôler régulièrement et de vérifier qu’il soit bien activé.
• L’installation d’un dispositif de sécurité ne doit pas déresponsabiliser les propriétaires : rien ni personne ne peut remplacer la vigilance active d’un adulte désigné responsable de la surveillance de la baignade.
##img4694##
Graphique réalisé d’après les données de l’InVS et de la FPP
Les enfants, une population à risque
Les enfants de moins de 6 ans sont les premières victimes de noyade recensées dans les piscines privées familiales. Entre 2006 et 2012, cette classe d’âge représente systématiquement plus de 60 % du nombre total de victimes. L’intérêt des enquêtes Noyades menées par l’InVS depuis 2002 sur l’ensemble du territoire est de ne pas se cantonner au seul recensement de données chiffrées : elles répertorient le plus d’informations possibles pour cerner les circonstances des noyades accidentelles d’enfant dans une piscine familiale. Il en ressort que le manque de surveillance est la circonstance la plus fréquemment notifiée (58 % en moyenne entre 2003 et 2012), devant le fait de ne pas savoir nager (54 %) et la survenue d’une chute (44 %).
Les conseils prônés par la FPP sont parfaitement en phase avec ces chiffres. Dans ses différentes publications, il est rappelé la nécessité que les enfants soient surveillés par un adulte de manière rapprochée et active : en aucun cas un système de sécurité ne se substitue à la constance d’une vigilance individuelle. Le recours à un équipement de protection individuelle (brassard, bracelet) peut également constituer une protection supplémentaire contre le risque de noyade. La FPP insiste enfin sur l’importance d’apprendre à nager aux enfants le plus tôt possible et soutient à ce titre l’initiative «Eautonomie aquatique» des maîtres-nageurs sauveteurs.
##img4700##Source : enquêtes Noyades réalisées du 1er juin au 30 septembre 2003, 2004, 2006, 2009, 2012, sur toute la France par l’InVS.
La loi du 03/01/2003 relative à la sécurité des piscines
Porté par le sénateur Jean-Pierre Raffarin à la suite de la pression de certaines associations, le projet de loi sur la sécurité des piscines est paru au Journal officiel le 3 janvier 2003.
Cette loi n° 2003-9 prévoit que les piscines enterrées et semi-enterrées privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé pour prévenir le risque de noyade. Cette disposition réglementaire s’applique à toutes les piscines neuves à compter du 1er janvier 2004 (cf. art. L. 128-1). Pour les piscines enterrées réalisées avant cette date, les propriétaires avaient jusqu’au 1er janvier 2006 pour équiper leur bassin (cf. art. L. 128-2).
Ne sont pas concernées par cette loi les piscines couvertes, totalement hors-sol, et les piscines publiques ou établissements de natation qui relèvent de la loi de 1951.
Les différents dispositifs de sécurité prévus par la loi
Le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation, fixe les exigences auxquelles doivent se conformer les 4 dispositifs de sécurité retenus par la loi.
Concrètement, au travers de l’article R.128-2.–II, il met en application une série de 4 normes publiées en mai 2004 traitant des caractéristiques, performances et résistance des matériaux, des exigences relatives à la conception, à la construction et au contrôle des dispositifs de sécurité, mais aussi des instructions pour le consommateur (information, conseils d’installation, d’utilisation, d’entretien et de sécurité) ainsi que des règles de marquage des produits :
• « Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans. » L’ensemble des impératifs normatifs est défini par la norme NF P90-309.
##img4706##
• « Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure. » La norme NF P90-308 en détaille spécifiquement les exigences.
##img4712##
• « Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure. » C’est la norme NF P90-306 qui encadre précisément ce dispositif.
##img4748##
##img4754##
• Quant aux alarmes, elles « doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. » La norme NF P90-307 précisant les modalités de la conformité a été remplacée en 2009 par la norme NF P90-307-1 publiée en avril 2009 (pour les alarmes périmétriques) et le décret 2009-873 (pour les alarmes par détection d’immersion) entré en vigueur depuis le 19 janvier 2010.
##img4730##
L’efficacité des dispositifs de sécurité normalisés
Les trois dernières campagnes d’enquêtes Noyades ont affiné un certain nombre de critères afin d’appréhender les circonstances des accidents impliquant des enfants de moins de 6 ans dans le cadre des piscines privées familiales. La loi de 2003 ayant notamment été justifiée par la volonté de lutter contre les noyades des enfants, l’enjeu de ces enquêtes était entre autres de mesurer le degré d’efficacité des dispositifs de sécurité normalisés.
Si l’on se concentre sur les piscines familiales enterrées, il apparaît que le nombre de noyades d’enfant de moins de 6 ans ayant lieu durant la baignade (en couleur dans le tableau ci-dessous) fluctue peu. Les dispositifs de sécurité sont désactivés lors des baignades et n’apportent dans ce cas aucune protection. Cela peut expliquer que le nombre de décès dans ces circonstances reste stable : un jeune enfant qui échappe à la vigilance d’un adulte peut rapidement se noyer sans que les personnes présentes dans le bassin ne s’en rendent compte.
Typologie des accidents concernant des enfants de moins de 6 ans recensés dans les piscines familiales enterrées :
##img4736##
Source : données de l’InVS collectées entre les 1er juin et 30 septembre 2006, 2009, 2012.
L’analyse des accidents hors baignade, lorsque le dispositif de sécurité est censé être actif, révèle que le nombre de décès d’enfants de moins de 6 ans est en baisse depuis 2006, alors que le nombre de noyades a augmenté. La proportion de décès d’enfants de moins de 6 ans ayant lieu hors baignade a donc diminué. La conclusion du rapport de l’InVS est la suivante : « Cette juxtaposition de résultats est plutôt en faveur d’une certaine efficacité des dispositifs de sécurité. On peut supposer que les dispositifs en place ont pu contribuer à garder la vie sauve à certains enfants », le système d’alerte ayant pu avertir à temps les adultes de la présence dans le bassin d’un enfant.
L’étude détaillée des décès d’enfants de moins de 6 ans dans une piscine familiale enterrée apporte un enseignement supplémentaire : en 2006 et en 2012, tous les décès enregistrés hors baignade l’ont été alors que le dispositif de sécurité était soit absent, soit déficient, soit non-activé, soit non-conforme à la réglementation en vigueur. D’après l’InVS, « on peut supposer que l’absence de dispositif a pu représenter l’absence de “dernière protection‿ contre la noyade. »
Typologie des décès concernant des enfants de moins de 6 ans recensés dans les piscines familiales enterrées :
##img4742##Graphique réalisé d’après les données de l’InVS collectées entre les 1er juin et 30 septembre 2006, 2009, 2012.
Le rôle du piscinier
Depuis la réglementation de 2003, le piscinier a l’obligation d’informer et de conseiller le client sur l’application de la loi relative à la sécurité des piscines et sur certaines bonnes pratiques en matière de prévention. Il est donc tenu de rappeler l’existence de cette loi et des impératifs qui en découlent. Concrètement, il doit fournir au client une note technique présentant les 4 dispositifs reconnus par la loi ou, le cas échéant, la note technique indiquant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif retenu.
De la contrainte à l’opportunité
Ce qui pourrait sembler à première vue un frein à la vente, risquant de dissuader des clients en phase de projet, peut se transformer en potentialité commerciale permettant de mettre en avant l’importance des équipements de sécurité.
Le rappel des obligations légales peut ainsi s’accompagner de l’exposé de leur bien-fondé, ne serait-ce qu’en soulignant le fait qu’un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d’eau ou qu’une part importante de la population (21 % des 15-85 ans) ne sait pas nager. Surtout, il est important de montrer l’efficacité des dispositifs prévus par la loi au regard des statistiques en insistant sur le fait que cette efficacité relève d’un haut degré d’exigence, fixé par une norme et attesté par des contrôles menés par des organismes indépendants.
En s’appuyant sur des chiffres officiels et en plaçant la réglementation comme une garantie et non pas comme une contrainte, un tel argumentaire peut être déclencheur d’achat et permettra de générer un chiffre d’affaires supplémentaire auprès des porteurs de projets mais aussi des propriétaires existants : selon une étude de la FPP, en 2007, 25% des piscines n’étaient pas équipées d’un système de sécurité.
La spécificité des alarmes par détection d’immersion
Compte tenu des différentes campagnes de sensibilisation et des risques encourus en cas de non-respect de la loi, on peut penser que le fait de ne pas équiper son bassin d’un dispositif de sécurité est principalement motivé par un problème d’ordre financier. De ce point de vue, les alarmes immergées constituent une solution adaptée aux petits budgets et pouvant répondre aux besoins de plusieurs dizaines de milliers de bassins. Un potentiel commercial non négligeable.
Comme tous les dispositifs prévus par la loi de 2003, les alarmes immergées doivent respecter un cahier des charges précis, fixé par la réglementation. Ce cadre a initialement été défini par la norme NF P90-307. Celle-ci s’est avérée pas assez détaillée, mettant à mal la confiance des utilisateurs et de certains professionnels, confrontés à un fonctionnement pas suffisamment fiable. Afin de combler les manques de la première version de la norme, le décret 2009-873 a été mis en application pour exiger une réponse aux problèmes de déclenchement intempestif. Les constructeurs sont laissés libres de définir quelles sont les solutions à apporter, mais ils ont un impératif de résultat fixé par ce décret. Cela donne lieu à des contrôles effectués par des laboratoires accrédités par le COFRAC, les seuls habilités à délivrer une attestation de conformité avec le décret. De nouvelles techniques ont été développées, le niveau d’exigence ayant clairement été revu à la hausse afin de limiter au maximum la sensibilité des capteurs au vent. Il s’agissait de la principale faiblesse des alarmes par détection d’immersion : leur propension à se déclencher à cause des remous naturels à la surface avait pour conséquence d’inciter les propriétaires à les désactiver, leur bassin n’étant dans ce cas plus sécurisé.
Depuis le 19 janvier 2010, seule la commercialisation des modèles conformes au décret 2009-873 est autorisée. Les systèmes par détection d’immersion présents sur le marché sont donc des alarmes plus fiables, bien moins sensibles aux déclenchements intempestifs. Accessible financièrement, ce dispositif permet ainsi de sécuriser à moindre coût son bassin. Il ne faut donc pas hésiter à proposer cette solution, économique certes, mais qui peut constituer une porte d’entrée future vers d’autres gammes d’équipements.