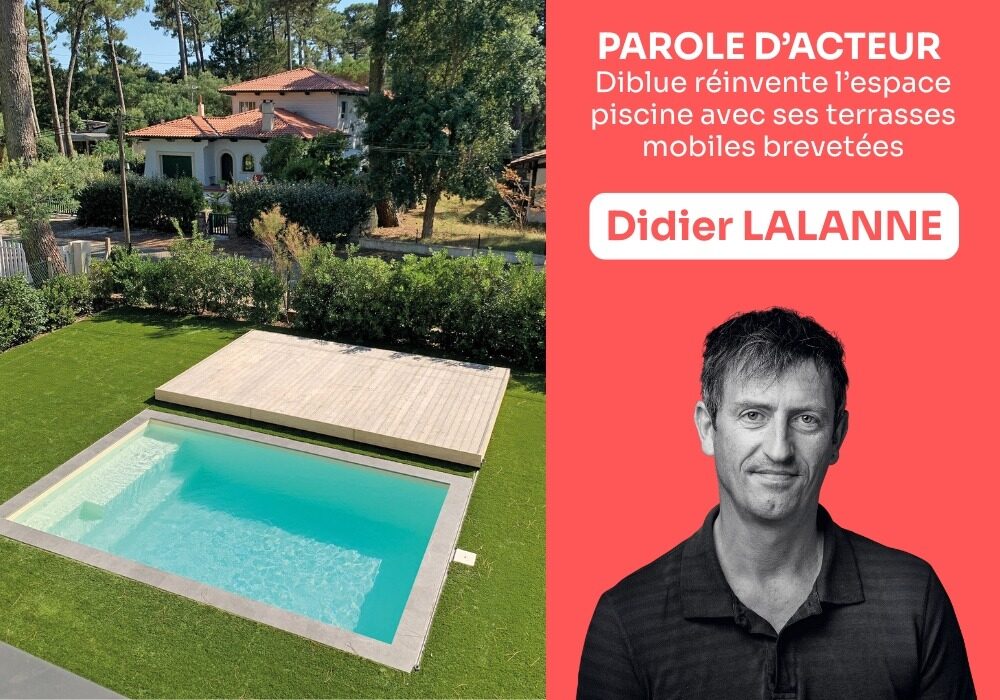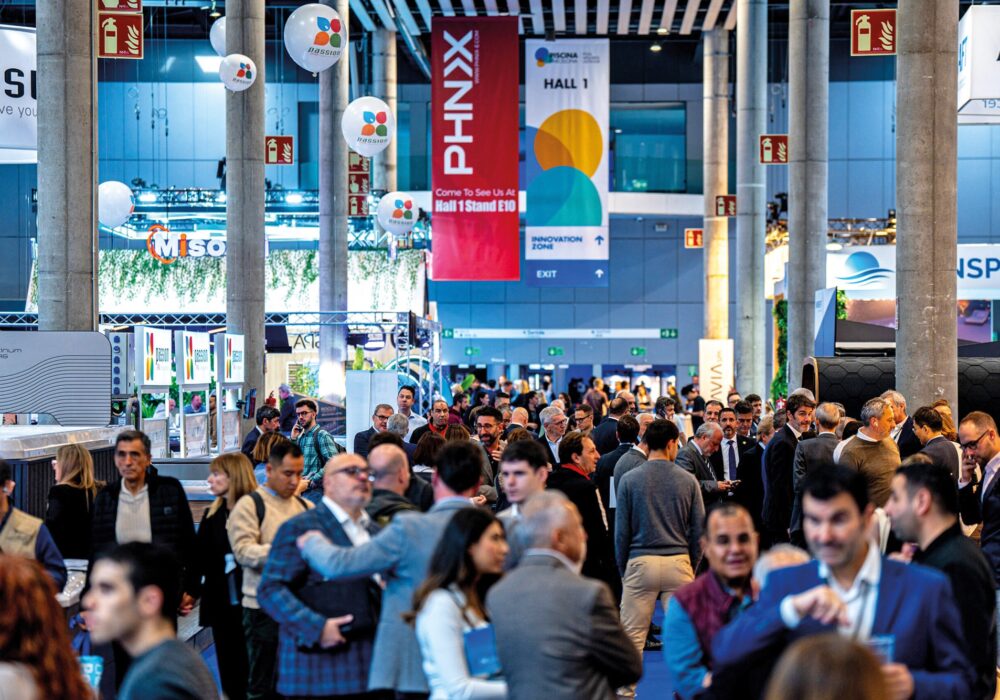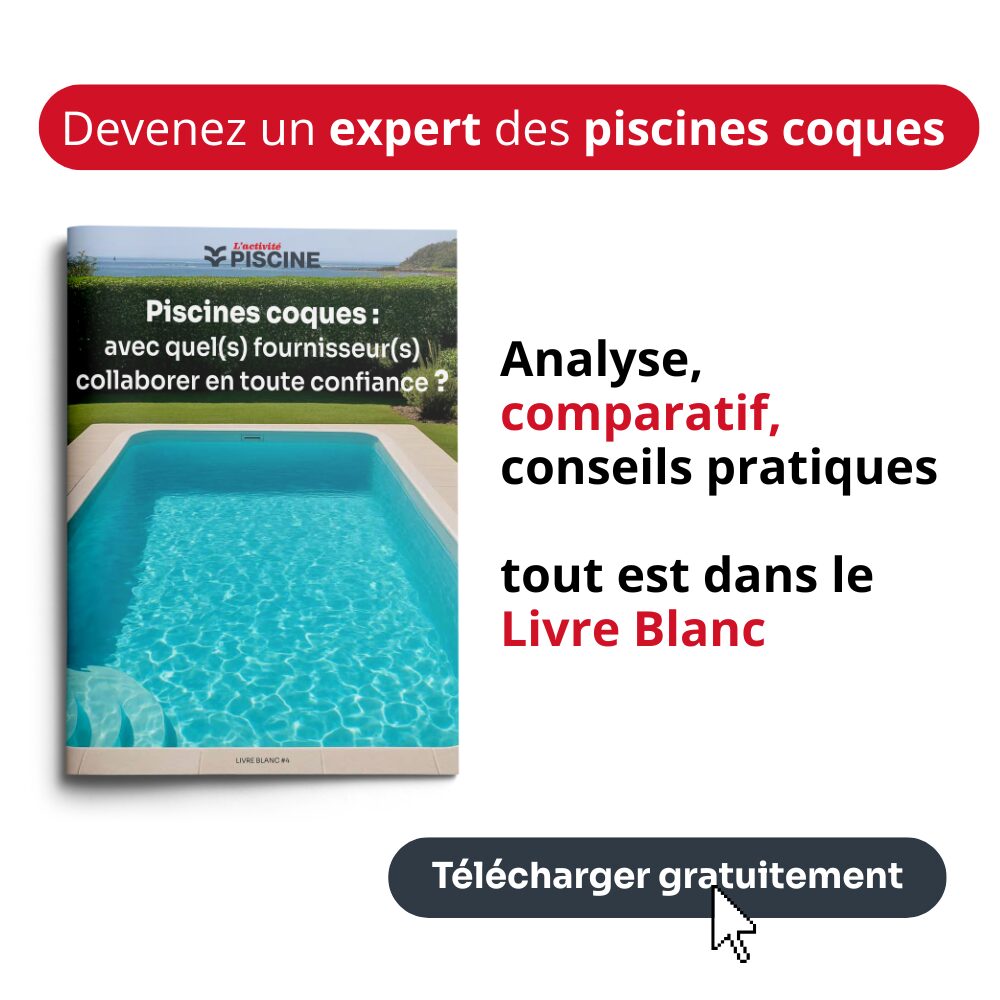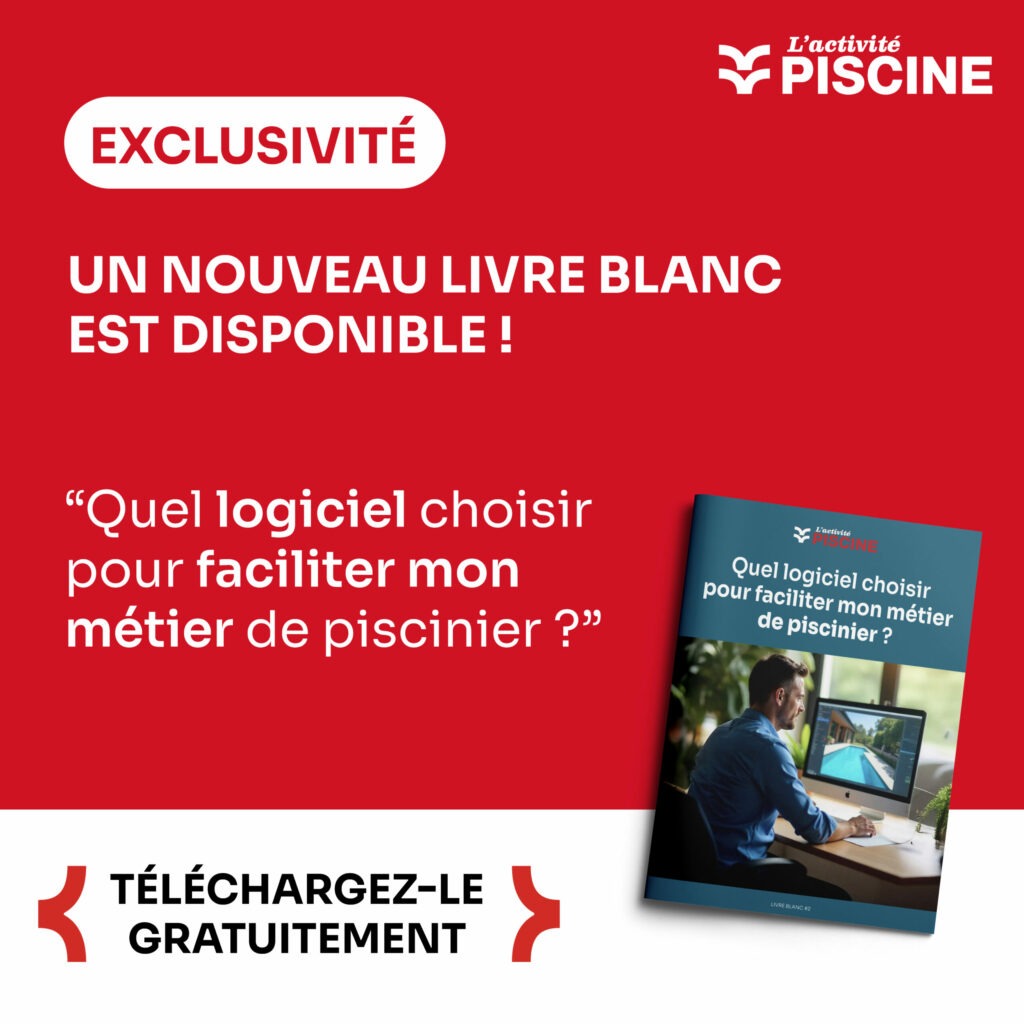À Montignac-Lascaux (Dordogne), la piscine municipale a été transformée en baignade biologique. Jean-Pierre Rodrigues, du cabinet d’architecture Atelier RK, revient sur cette métamorphose et ses bénéfices, aussi bien pour les usagers que pour l’environnement.

Un projet au long cours
« Fermée au public depuis 2018, l’ancienne piscine municipale, devenue vétuste, n’était plus exploitable. L’installation était désuète, les fuites constatées trop importantes et coûteuses à gérer. Les plages étaient potentiellement blessantes et les espaces sanitaires trop dégradés pour être rénovés. L’ensemble nécessitait une reprise complète. Le cabinet Atelier RK a répondu à un appel d’offres classique et a été retenu pour mener à bien cette transformation.
Les premières difficultés sont apparues dès le lancement du projet, en 2022, et ont perduré jusqu’à la fin du chantier. Il a d’abord fallu convaincre les parties prenantes de l’intérêt d’une baignade biologique — une solution pourtant pertinente pour l’avenir, aussi bien en termes d’impact environnemental que de confort d’usage. La phase administrative s’est révélée particulièrement complexe.
Les services départementaux de l’ARS étaient réticents, les élus restaient hésitants, et nous avons dû défendre notre proposition sur tous les fronts.
Il nous a fallu près d’un an pour rallier l’ensemble des acteurs au bien-fondé du projet. À cela s’ajoutaient deux difficultés majeures : le peu de retours d’expérience sur ce type de réalisation, et le nombre restreint d’entreprises capables de mener à bien un chantier aussi spécifique ».


Des avantages reconnus
« Au-delà de ses bénéfices écologiques, la baignade biologique présente aussi un avantage financier : sa construction peut coûter jusqu’à 30 % de moins qu’un bassin traditionnel. On travaille ici moins sur des infrastructures techniques que sur la mise en place d’un écosystème fonctionnel, associé à la création d’un paysage spécifique.
Dans ce projet, les travaux ont commencé par le démontage de l’ancien bassin. Nous avons ensuite conservé une partie des structures existantes pour y poser la feutrine et la bâche d’étanchéité, puis nous avons entièrement remanié les réseaux.
Contrairement à une piscine classique, où l’on traite l’eau à l’aide de produits chimiques, ici, c’est le vivant qui entre en jeu. Un véritable écosystème se met en place, dans lequel la chimie naturelle issue des plantes assure le traitement de l’eau. Celle-ci traverse successivement plusieurs couches de granulats volcaniques avant de nourrir les racines des roseaux du biofiltre, puis repart vers les bassins de baignade. Ce cycle complet dure environ huit heures.
La vigilance reste de mise à chaque instant pour garantir la qualité sanitaire de l’eau. Nous avons volontairement mis en place un protocole de fonctionnement plus strict que celui exigé par la réglementation, notamment en laissant davantage de temps à l’eau pour « se reposer » entre deux cycles. Le nettoyage est plus fréquent, et chacun veille à la santé des plantes comme à celle des baigneurs. Enfin, pour prévenir l’apparition d’éventuelles bactéries pathogènes, un filtre UV a été installé en fin de cycle, juste avant le retour de l’eau vers les zones de baignade ».


L’avenir passera par ce type de baignades
« Contrairement à une piscine classique, la baignade biologique ne contraint pas les usagers à suivre des rituels stricts avant l’entrée dans l’eau : pas de pédiluve, et la douche reste facultative. Ici, l’être humain fait partie intégrante du système : sa présence ne perturbe pas l’équilibre, elle y contribue. Le lieu est pensé pour être convivial, naturel, loin des ambiances aseptisées. On y profite de la douceur de l’eau, des odeurs végétales, comme celle de la menthe, de la fraîcheur de l’herbe ou encore de l’ombre offerte par les plantations environnantes.
Bien que complexe à mettre en œuvre, ce projet affiche aujourd’hui un bilan très positif, grâce au professionnalisme des entreprises partenaires qui nous ont accompagnés tout au long du chantier. Nous sommes convaincus que ce type de baignade représente une voie d’avenir, notamment pour les petites communes.
Son coût de construction réduit, ses frais d’entretien maîtrisés, la mobilisation restreinte de personnel et sa dimension écologique en font une alternative séduisante aux équipements traditionnels. Certes, ces structures à eau vive ne se prêtent pas à l’organisation de compétitions de natation, mais elles pourraient compléter efficacement les bassins traditionnels, à condition de penser un maillage territorial intelligent à l’échelle de l’Hexagone ».

Propos recueillis par Cécile Olivéro – Photos : Atelier RK et Éric Solé